Emile
accueil > Emile
Emile, reviens vite - ils sont devenus fous (Philippe Meirieu, Michel Develay)
Cette partie du site didac-TIC est consacrée à une réflexion sur l'école à partir une présentation de travaux de philosophes, de didacticiens et d'historiens.
La pédagogie, inclusive et émancipatrice, celle des méthodes dites actives peut trouver son origine chez Rousseau d'où le titre de cete page et de cette partie du site Didac-TIC.
Emile ou de l'éducation ↑
Jean-Jacques Rousseau publie ce traité d'éducation en 1762, en parallèle avec Du Contrat social. Le livre reste l'un des plus populaires dans le domaine éducatif et sa lecture fait toujours partie de la formation des instituteurs... japonais.Pour Rousseau l'enfant n'est pas un adulte en miniature, une idée qui sera considérablement développée par jean Piaget.
L'homme étant "bon" par nature, c'est en le préservant des (mauvaises) influences extérieures qu'on peut produire un citoyen autonome. Plus exactement, l'homme [sauvage] n'est n'est pas bon, mais vierge: «De même l’enfant livré à lui-même dans la nature (souvent, nous l’avons constaté, enfant naturel chez les romanciers) n’est ni bon ni méchant; il ignore le bien et le mal et vit dans une béate innocence, sans sentiment de culpabilité, comme Adam et Ève avant la faute.» L'Emile est une anthropologie politique permettant la transformation sociale (Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’inégalité, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1971, t. II, p. 223.).
Comme souvent chez Rousseau, la pensée est complexe et l'expression manie les paradoxes permettant parfois toutes les réutilisations. Rousseau utilisant abondamment le terme de nature (comme on le constate dans la citation précédente), il convient de s'interroger sur le sens ou les sens qu'il donne à cette notion d'autant plus que l'anthopologie moderne attribue souvent au "siècle des lumières" la généralisation de l'idée d'un dualisme entre nature et culture.
Dans notre société naturaliste (Philippe Descola, 2005), nous avons déjà différentes définitions de la nature:
- éléments biophysiques non humains d'un environnement, par opposition à la culture dont relève toute production anthropique;
- mais la culture peut se limiter à la représentation que nous nous faisons de nos interactions avec l'environnement.

18e siècle; crédit: wikimedia.
«Supposons que, tandis que j’étudie avec mon élève le cours du soleil et la manière de s’orienter, tout à coup il m’interrompe pour me demander à quoi sert tout cela. Quel beau discours je vais lui faire ! de combien de choses je saisis l’occasion de l'instruire en répondant à sa question [...], surtout si nous avons des témoins de notre entretien. Je lui parlerai de l’utilité des voyages, des avantages du commerce, des productions particulières à chaque climat, des mœurs des différents peuples, de l’usage du calendrier, de la supputation du retour des saisons pour l’agriculture, de l’art de la navigation, de la manière de se conduire sur mer et de suivre exactement sa route, sans savoir où l'on est. La politique, l’histoire naturelle, l’astronomie, la morale même et le droit des gens entreront dans mon explication, de manière à donner à mon élève une grande idée de toutes ces sciences et un grand désir de les apprendre. Quand j’aurai tout dit, [...] Il [Emile] aurait grande envie de me demander comme auparavant à quoi sert de s’orienter; mais il n'ose, de peur que je me fâche. [...]
Le lendemain matin, je lui propose un tour de promenade avant le déjeuner; il ne demande pas mieux; pour courir, les enfants sont toujours prêts, et celui-ci a de bonnes jambes. Nous montons dans la forêt, nous parcourons les Champeaux, nous nous égarons, nous ne savons plus où nous sommes; et, quand il s’agit de revenir, nous ne pouvons plus retrouver notre chemin. [...]
Après quelques moments de silence, je lui dis d’un air inquiet : Mon cher Emile, comment ferons-nous pour sortir d’ici ?
Emile, en nage, et pleurant à chaudes larmes. Je n’en sais rien. Je suis las ; j’ai faim ; j’ai soif ; je n’en puis plus.
Jean-Jacques Me croyez-vous en meilleur état que vous ? et pensez-vous que je me fisse faute de pleurer, si je pouvais déjeuner de mes larmes ? Il ne s’agit pas de pleurer, il s’agit de se reconnaître. Voyons votre montre ; quelle heure est-il ?
Emile Il est midi, et je suis à jeun.
Jean-Jacques Cela est vrai, il est midi, et je suis à jeun.
Emile Oh ! que vous devez avoir faim !
Jean-Jacques Le malheur est que mon dîner ne viendra pas me chercher ici. Il est midi : c’est justement l’heure où nous observions hier de Montmorency la position de la forêt. Si nous pouvions de même observer de la forêt la position de Montmorency !
Emile Oui ; mais hier nous voyions la forêt, et d’ici nous ne voyons pas la ville.
Jean-Jacques Voilà le mal… Si nous pouvions nous passer de la voir pour trouver sa position !
Emile O mon bon ami !
Jean-Jacques Ne disions-nous pas que la forêt était...
Emile Au nord de Montmorency.
Jean-Jacques Par conséquent Montmorency doit être...
Emile Au sud de la forêt.
Jean-Jacques Nous avons un moyen de trouver le nord à midi ?
Emile Oui, par la direction de l’ombre.
Jean-Jacques Mais le sud ?
Emile Comment faire ?
Jean-Jacques Le sud est l’opposé du nord.
Emile Cela est vrai ; il n’y a qu’à chercher l’opposé de l’ombre. Oh ! voilà le sud ! voilà le sud ! sûrement Montmorency est de ce côté.
Jean-Jacques Vous pouvez avoir raison : prenons ce sentier à travers le bois.
Emile, frappant des mains, et poussant un cri de joie. Ah ! je vois Montmorency ! le voilà tout devant nous, tout à découvert. Allons déjeuner, allons dîner, courons vite : l’astronomie est bonne à quelque chose.
Prenez garde que, s'il ne dit pas cette dernière phrase, il la pensera ; peu importe, pourvu que ce ne soit pas moi qui la dise. Or soyez sûr qu’il n’oubliera de sa vie la leçon de cette journée ; au lieu que, si je n’avais fait que lui supposer tout cela dans sa chambre, mon discours eût été oublié dès le lendemain. Il faut parler tant qu’on peut par les actions, et ne dire que ce qu'on ne saurait faire.»
Le lendemain matin, je lui propose un tour de promenade avant le déjeuner; il ne demande pas mieux; pour courir, les enfants sont toujours prêts, et celui-ci a de bonnes jambes. Nous montons dans la forêt, nous parcourons les Champeaux, nous nous égarons, nous ne savons plus où nous sommes; et, quand il s’agit de revenir, nous ne pouvons plus retrouver notre chemin. [...]
Après quelques moments de silence, je lui dis d’un air inquiet : Mon cher Emile, comment ferons-nous pour sortir d’ici ?
Emile, en nage, et pleurant à chaudes larmes. Je n’en sais rien. Je suis las ; j’ai faim ; j’ai soif ; je n’en puis plus.
Jean-Jacques Me croyez-vous en meilleur état que vous ? et pensez-vous que je me fisse faute de pleurer, si je pouvais déjeuner de mes larmes ? Il ne s’agit pas de pleurer, il s’agit de se reconnaître. Voyons votre montre ; quelle heure est-il ?
Emile Il est midi, et je suis à jeun.
Jean-Jacques Cela est vrai, il est midi, et je suis à jeun.
Emile Oh ! que vous devez avoir faim !
Jean-Jacques Le malheur est que mon dîner ne viendra pas me chercher ici. Il est midi : c’est justement l’heure où nous observions hier de Montmorency la position de la forêt. Si nous pouvions de même observer de la forêt la position de Montmorency !
Emile Oui ; mais hier nous voyions la forêt, et d’ici nous ne voyons pas la ville.
Jean-Jacques Voilà le mal… Si nous pouvions nous passer de la voir pour trouver sa position !
Emile O mon bon ami !
Jean-Jacques Ne disions-nous pas que la forêt était...
Emile Au nord de Montmorency.
Jean-Jacques Par conséquent Montmorency doit être...
Emile Au sud de la forêt.
Jean-Jacques Nous avons un moyen de trouver le nord à midi ?
Emile Oui, par la direction de l’ombre.
Jean-Jacques Mais le sud ?
Emile Comment faire ?
Jean-Jacques Le sud est l’opposé du nord.
Emile Cela est vrai ; il n’y a qu’à chercher l’opposé de l’ombre. Oh ! voilà le sud ! voilà le sud ! sûrement Montmorency est de ce côté.
Jean-Jacques Vous pouvez avoir raison : prenons ce sentier à travers le bois.
Emile, frappant des mains, et poussant un cri de joie. Ah ! je vois Montmorency ! le voilà tout devant nous, tout à découvert. Allons déjeuner, allons dîner, courons vite : l’astronomie est bonne à quelque chose.
Prenez garde que, s'il ne dit pas cette dernière phrase, il la pensera ; peu importe, pourvu que ce ne soit pas moi qui la dise. Or soyez sûr qu’il n’oubliera de sa vie la leçon de cette journée ; au lieu que, si je n’avais fait que lui supposer tout cela dans sa chambre, mon discours eût été oublié dès le lendemain. Il faut parler tant qu’on peut par les actions, et ne dire que ce qu'on ne saurait faire.»
Emile, ou De l’éducation, édition 1852, Livre 3 pp.504-505 (Wikisource).
Avec la leçon en forêt, Rousseau invente les méthodes actives, la classe dans la nature, la mise en situation (situation-problème)...
Cela fait déjà beaucoup, même si aujourd'hui on s'oppose le plus souvent à Rousseau sur sa vision individualiste de l'éducation.
Les enfants sauvages ↑
L'histoire a enregistré (et parfois enjolivé) une multitude de cas d'enfants ayant grandi hors de la société humaine pendant quelques unes des premières années de leur vie et adoptés par des animaux sauvages (Singes, Loups, etc.). Leur étude met en évidence un paradoxe: reposant sur l'idée que l'humain fait partie de la nature et du monde vivant, ces cas révèlent la nécessité des interactions entre l'enfant et la société pour tout développement humain, même rudimentaire. Il est cependant difficile de faire la part entre mythe et réalité, la documentation étant dans le meilleur des cas très fragmentaire. Ces faits viennent cependant en contrepoint des idées rousseauistes.En 1968 dans un texte assez superficiel, Lucien Malson recense une cinquantaine de cas (p.72) et en détaille trois. Tout en posant la principale difficulté de l'étude: l'alternative entre l'explication par la maladie mentale (qui provoque l'abandon de l'enfant) et l'éducation isolée de la société humaine (qui provoque la déficience intellectuelle), Malson évacue plutôt vite le premier choix. Il le réserve à la description de l'histoire de Gaspard (Kaspar Hauser), le seul exemple précis opposé aux fillettes (Amala_et_Kamala) de Godamuri et à Victor de l'Aveyron .
Ces deux cas d'enfants sauvages détaillés par Malson sont aujourd'hui controversés. Pour l'un comme pour l'autre le contradicteur écrit sous le pseudonyme de Serge Aroles, et serait un chirurgien français. Reprenant les archives disponibles, Aroles évoque les cas d'enfants-loups répertoriés de 1304 à 1954, et considère qu'ils sont tous falsifiés, à part l'histoire de Marie-Angélique (citée par Malson sans plus de précisions). Il s'avère difficile d'accorder plus de confiance à Aroles qu'aux écrits qu'il dénonce. L'ouvrage est plus polémique que scientifique, les éléments proprement scientifiques sont dispersés dans nombre de considérations anecdotiques et spectaculaires. Le rejet quasi-systématique et la violence des accusations d'Aroles ne peuvent que susciter la méfiance. Le relatif échec des tentatives de rééducation n'est pas suffisant pour invoquer une maladie d'ordre génétique. On peut y voir deux approches opposées de la psychiatrie.
Pour Lev Vygotsky (Vygotsky, 1934), le développement intellectuel de l'enfant est fonction des groupes humains plutôt qu'un processus individuel.
Marie-Angélique le Blanc (1731)
L'extraordinaire aventure de cette autochtone de la tribu des Meskwakis (Haute-Louisiane, occupée à l'époque par les français) commence vers 1712.C'est un des rares cas d'enfant sauvage capable de parler (et même de lire et d'écrire), mais elle a vécu avec ses parents jusqu'à six ans et deux ans de plus avec une française.
Peu après sa naissance et suite à des batailles perdues par sa tribue, elle est vendue comme esclave. Elle est recueillie en 1718 par une française, madame de Courtemanche qui se trouve contrainte par les conflits coloniaux de regagner la France deux ans plus tard. Débarquant à Marseille lors d'une épidémie de peste et sans ressources, madame de Courtemanche abandonne celle qu'elle considère pourtant comme sa fille adoptive.Travaillant dans une filature, Marie-Angélique y recontre une jeune esclave noire et réussit à s'enfuir avec elle. Les deux filles vont survivre en forêt pendant 9 ans, ne communiquant que par des gestes et des cris.
Le 7 septembre 1731, sa compagne d'aventure est abattue par un habitant de Bar de Saint-Martin, en Champagne. Capturée le lendemain, Marie-Angélique est transférée dans un hospice puis dans différents couvents. Baptisée en 1732, elle est protégée par Louis d'Orléans, cousin du roi, à partir de 1744; il la fait venir dans un couvent à Paris en 1750. Elle a alors à peu près 24 ans, mais c'est à cette époque que son acte de baptème est falsifié pour la rajeunir de 9 ans. Cette falsification escamotte les années de vie sauvage qui gènent ses protecteurs. Alors qu'elle se destine au noviciat, elle chute d'une fenêtre et son protecteur, Louis d'Orléans meurt. En 1752 elle est jetée à la rue. En 1753, elle parvient cependant à obtenir de la reine de France, Marie Leszczynska, une pension annuelle.
Dans le couvent des Hospitalières de la rue Mouffetard, Marie-Angélique rédige, en 1753, avec l'aide d'une "dame de charite"́, Marie-Catherine Hecquet (et peut-être de La Condamine), des souvenirs publiés sous le titre: Histoire d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l'âge de dix ans (les souvenirs reprennent l'âge falsifié du baptème). Publié deux ans plus tard l'ouvrage rencontre un franc sucès; il contient cependant des inexactitudes et attribue à Marie-Angélique des origines esquimaudes. Aucun détail n'est donné sur la manière dont Marie-Angélique à récupéré le langage parlé.
Même sa mort le 15 décembre 1775 reste digne d'un scénario à rebondissement. Décédée brutalement, sans héritier, un empoisonnement peut même être envisagé alors qu'elle a prêté de l'argent à un bourgeois de Bourgogne.
James Burnett enquête sur Marie-Angélique en 1765, et l'interroge longuement, identifiant sa langue comme appartenant à la vaste famille de l'algonquin. Incapable de parler lors de sa capture en 1731 elle récupère la parole et acquiert une maitrise de la lecture et de l'écriture.
Dans les tomes 3 et 4 de son Histoire naturelle, Buffon évoque Marie-Angélique et son incapacité à parler avant sa capture.
Les projets de mise en scène de cette vie incroyable, en particulier au cinéma, ont échoué jusqu'à présent. le village de Songy, lieu de sa capture, lui a élevé une statue en 2009. Un roman d'Anne Cayre est paru en 2013 et en 2015 une biographie en bande dessinée s'appuyant sur l'enquête de Serge Aroles.
Victor de l'Aveyron (1797)
Le cas de Victor de l'Aveyron, popularisé par le livre de Lucien Malson (1964) et le film de François Truffaut est aujourd'hui plus discuté. En 1800 il est "capturé" à Saint-Sernin-sur-Rance où il s'est déplacé volontairement. Après une première tentative suivie d'une fugue 3 ans plus tôt. Il est agé d'une dizaine d'années, se nourrit de fruits à coque et de pommes de terre (Bonnaterre) et semble sourd et muet.Le médecin Philippe Pinel, après l'avoir étudié le considère comme un malade mental. Transféré à Paris, il est pris en charge pendant 5 ans par Jean Itard, jeune médecin et éducateur qui lui donne son prénom, Victor. Au fil du temps Victor devient capable de communiquer par ses comportements, mais non par le langage, alors que c'était un des espoirs d'Itar.
Par rapport à d'autres enfants sauvages, si Victor apprécie les paysages de campagne, il montre peu d'habilités dans la nature, a peur du vide mais résiste bien au froid. En s'appuyant sur les nombreuses cicatrices citées dans les archives, Aroles en fait un enfant maltraité plus qu'un enfant abandonné dans la nature. Il est difficile d'aller beaucoup plus loin pour expliquer son origine. Victor meurt de pneumonie en 1828.
Amala_et_Kamala, les fillettes de Godamuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amala_et_Kamala
Conclusion provisoire
Les cas d'adoption entre espèces animales sont avérés, y compris à l'époque actuelle, et multiples. On ne voit pas pourquoi la même chose n'aurait pas pu se produire entre humains et autres espèces vivantes, surtout dans des civilisations ou l'abandon d'enfants était fréquent. L'abondance des récits mythiques et fictionnels sur le sujet n'est pas un hasard.La distinction évoquée par Malson entre les deux causes: maladie mentale et isolement de la société n'agit pas en tout ou rien. A part quelques maladies mentales dont l'origine est franchement physiologique, les autres présentent des symptômes dont la gravité est extrêmement variable; elles sont traitables par l'attention et la psychiatrie, de la même manière que les cas d'isolement; les traitements ne sont pas distinguables.
Et l'isolement qu'il résulte d'un abandon volontaire ou soit accidentel aura des conséquences fortement graduées en fonction de sa durée et de sa précocité.
Maladie mentale et isolement se renforcent l'un l'autre. Rejeter tous les cas d'isolement sous prétexte de maladie mentale comme le fait Aroles est une fausse piste.
↑ Marie-Catherine Hecquet. 1755. Histoire d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l'âge de dix ans. Duchesne éditeur-libraire. lire en ligne: Gallica.
James Burnett. Antient Metaphysics (6 vols, Edinburgh and London, Bell and Bradshute and T. Cadell, 1779–1799), vol. 4 (1795), Appendix, pp. 403–408.
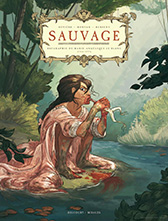 Gaëlle Hersent (dessin), Aurélie Bévière et Jean-David Morvan. 2015. Sauvage: biographie de Marie-Angélique Le Blanc: 1712-1775. Editions Delcourt. Aperçu (Google books).
Gaëlle Hersent (dessin), Aurélie Bévière et Jean-David Morvan. 2015. Sauvage: biographie de Marie-Angélique Le Blanc: 1712-1775. Editions Delcourt. Aperçu (Google books).
Serge Aroles. 2004. Marie-Angélique - Survie et résurrection d'une enfant perdue dix années en forêt. Terre-éd., Charenton-le-Pont, 2385 p. (ISBN 2-915587-01-9).
Serge Aroles est l'un des pseudonymes utilisés par Franck Rolin, un chirurgien et écrivain français, auteur de recherches historiques sur les enfants sauvages.
Marie-Angélique le Blanc. Wikipedia.
Pierre Joseph Bonnaterre. 1799. Notice historique sur le sauvage de l'Aveyron, et sur quelques autres individus qu'on a trouvés dans les forêts, à différentes époques. Gallica BnF
Paul C. Squires. 1927. "Wolf Children" of India. The American Journal of Psychology, Vol. 38, No. 2: pp. 313-315. doi.org/10.2307/1415228
Lucien Malson. 1964. Les Enfants sauvages, Mythe et réalité. UGE 10/18.
Le texte de Lucien Malson n'est pas sans a priori comme en témoigne la présence d'une introduction peu nuancée sur l'inné et l'acquis. Ce texte a plutôt mal vieilli et se révèle surtout aujourd'hui comme une longue introduction à deux mémoires de Jean Itard sur le Sauvage de l'Aveyron.
Jean Itard. 1801 et 1806. Mémoire et Rapport sur Victor de l'Aveyron. lire en ligne: Gallica
Serge Aroles. 2004. Les enfants-loups, 1344-1954. Terre-éd., Charenton-le-Pont.
Serge Aroles. 2007. L'énigme des enfants-loups: une certitude biologique mais un déni des archives. Publibook, Paris. ISBN 2-7483-3909-6. Premières pages sur Google books, Switch.
Feral child (enfant sauvage). Wikipedia (en).
James Burnett. Antient Metaphysics (6 vols, Edinburgh and London, Bell and Bradshute and T. Cadell, 1779–1799), vol. 4 (1795), Appendix, pp. 403–408.
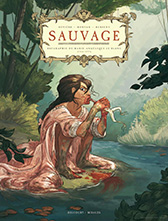
Serge Aroles. 2004. Marie-Angélique - Survie et résurrection d'une enfant perdue dix années en forêt. Terre-éd., Charenton-le-Pont, 2385 p. (ISBN 2-915587-01-9).
Serge Aroles est l'un des pseudonymes utilisés par Franck Rolin, un chirurgien et écrivain français, auteur de recherches historiques sur les enfants sauvages.
Marie-Angélique le Blanc. Wikipedia.
Pierre Joseph Bonnaterre. 1799. Notice historique sur le sauvage de l'Aveyron, et sur quelques autres individus qu'on a trouvés dans les forêts, à différentes époques. Gallica BnF
Paul C. Squires. 1927. "Wolf Children" of India. The American Journal of Psychology, Vol. 38, No. 2: pp. 313-315. doi.org/10.2307/1415228
Lucien Malson. 1964. Les Enfants sauvages, Mythe et réalité. UGE 10/18.
Le texte de Lucien Malson n'est pas sans a priori comme en témoigne la présence d'une introduction peu nuancée sur l'inné et l'acquis. Ce texte a plutôt mal vieilli et se révèle surtout aujourd'hui comme une longue introduction à deux mémoires de Jean Itard sur le Sauvage de l'Aveyron.
Jean Itard. 1801 et 1806. Mémoire et Rapport sur Victor de l'Aveyron. lire en ligne: Gallica
Serge Aroles. 2004. Les enfants-loups, 1344-1954. Terre-éd., Charenton-le-Pont.
Serge Aroles. 2007. L'énigme des enfants-loups: une certitude biologique mais un déni des archives. Publibook, Paris. ISBN 2-7483-3909-6. Premières pages sur Google books, Switch.
Feral child (enfant sauvage). Wikipedia (en).
Bibliographie
↑ Lev S. Vygotsky. 1934 (1962) Thought and Language. Cambridge Mass., MIT Press. (1985. Pensée et langage. Messidor, Ed. sociales).
↑ Philippe Descola. 2005 (2015). Par-delà nature et culture. Gallimard, Paris.
↑ Philippe Descola. 2005 (2015). Par-delà nature et culture. Gallimard, Paris.
Filmographie
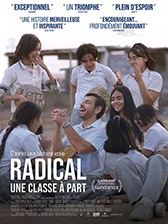
Alors que les films (souvent sombres) sur l'école se multiplient ces derniers temps le Mexique nous offre cette comédie dramatique comme petite lueur d'espoir et comme un encouragement au combat. Radical est un film formidable, un grand film. Plus de détails sur le blog de Didac-TIC.

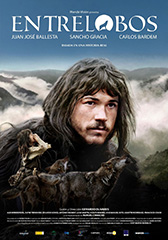
Adresse de cette page: http://www.didac-tic.fr/emile/index.php